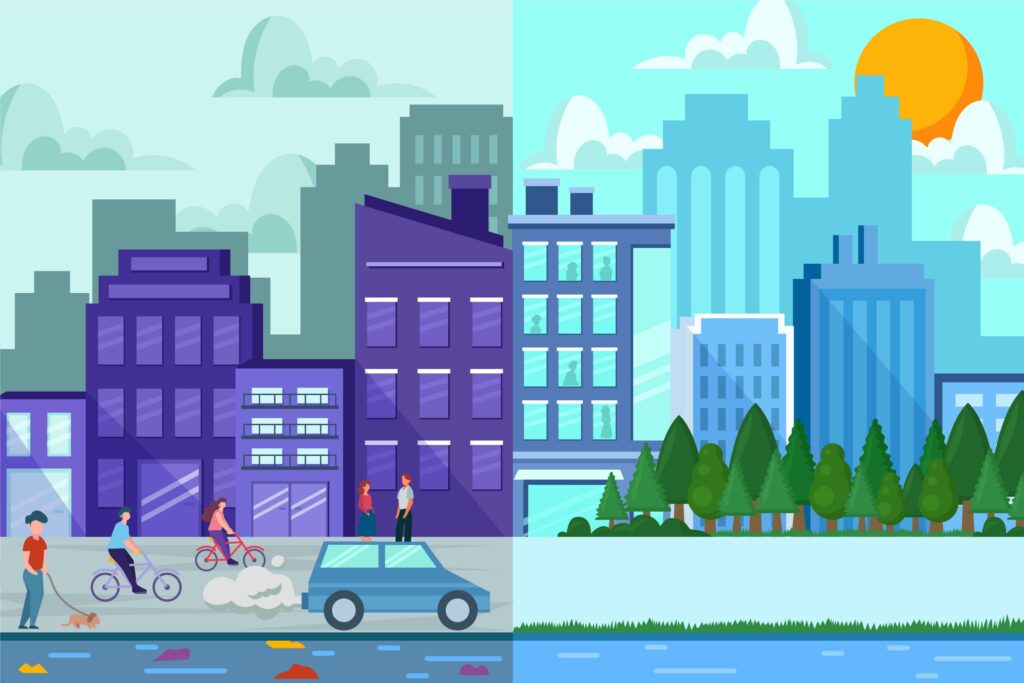Construire la Métropole de demain : et si nous le faisions vraiment ensemble ?
La Métropole de Lyon change, profondément. Et avec elle, notre façon de vivre, de travailler, de nous déplacer… Face à ces transformations, nous avons voulu écouter, comprendre et construire avec les citoyens.
C’est tout le sens de l’enquête que nous avons lancée avec notre collectif : une invitation à partager les constats qu’ils soient positifs ou négatifs, les colères parfois, mais surtout les idées pour bâtir ensemble notre territoire.
À travers cette enquête participative, une multitude de voix se sont exprimées. Voix souvent critiques, parfois inquiètes, mais aussi pleines de propositions, de visions concrètes et de volonté d’agir pour une métropole plus durable, plus accessible et plus humaine. Un message se dessine clairement : les habitants veulent être acteurs de la transformation de leur territoire. Et ils ont beaucoup à dire !
Le collectif Construisons demain est profondément attaché à l’écoute et au dialogue. Et le bilan que nous présentons aujourd’hui confirme ce que nous défendons depuis toujours : il est essentiel de construire l’avenir avec les citoyens, pas contre eux.
La voix des habitants, boussole de notre action
Cette enquête n’est pas anodine. Elle n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Pour nous, interroger les habitants a un véritable sens : c’est traduire une attente profonde et dessiner une prise de conscience collective. Ce n’est pas un simple recueil d’opinions : c’est une boussole politique pour construire ensemble la Métropole de demain.
Vers une métropole coopérative, sobre et ambitieuse
Ce qui se dégage de cette enquête, c’est un appel clair : celui d’une Métropole plus juste et plus humaine.
Une Métropole qui n’oppose pas piétons, cyclistes et automobilistes, mais qui organise leur cohabitation.
Une Métropole qui ne se limite pas à la ville-centre, mais qui pense tout son bassin de vie et d’attractivité.
Une Métropole qui prend soin des plus fragiles, qui soutient ses commerces de proximité et qui anticipe les bouleversements écologiques sans les imposer brutalement.
Nous, centristes, croyons à cette voie d’équilibre et de dialogue. Une voie qui ne sacrifie ni l’économie, ni l’écologie, ni la cohésion sociale, mais qui les conjugue pour faire évoluer la société positivement. Une voie où la participation citoyenne est une boussole réelle — et non un alibi.
Ce que cette enquête confirme, c’est l’envie d’un autre modèle. Moins vertical, moins idéologique. Un modèle qui favorise la cohabitation plutôt que l’opposition. Un modèle où l’on ne construit pas la ville pour, mais avec ses habitants. Où l’on concilie sobriété écologique, solidarité sociale et attractivité économique.
Nous croyons à cette voie du dialogue, du bon sens et de la confiance. Et vous nous avez rappelé, avec force, à quel point elle est attendue.
Ce que vous nous avez dit : les grands défis d’une Métropole en mutation
#1 L’environnement : répondre concrètement à l’urgence climatique, mais dans le dialogue collectif
- «On ne conteste pas l’écologie. On conteste l’écologie punitive. »
- « La transition doit être juste, progressive et surtout, collective. »
- « On veut plus d’arbres, pas seulement en Presqu’île. »
- « Il y a un discours, mais sur le terrain ça ne plante pas beaucoup. »
- « Les écolos parlent beaucoup, mais les arbres, on les attend toujours. »
- « Qu’on plante vraiment, qu’on aménage les cours d’école, les trottoirs, pas juste les berges. »
- « La transition doit être pensée avec les communes rurales et périphériques. »
- « La ZFE est une bonne idée à condition qu’elle soit bien expliquée. »
- « La ZFE, c’est violent. On nous impose sans proposer d’alternative. »
- « Arrêtons d’opposer écologie et vie quotidienne. Il faut une écologie de terrain, pas idéologique.”
L’environnement apparaît comme la préoccupation numéro un des habitants interrogés. Le climat n’est plus perçu comme une urgence lointaine, mais comme une réalité quotidienne : chaleur étouffante dans certains quartiers, manque d’espaces ombragés, gestion de l’eau ou encore pollution persistante.
Les politiques de végétalisation menées par la Métropole sont globalement saluées, mais beaucoup soulignent un sentiment d’inachèvement : actions trop concentrées dans les quartiers centraux, manque de continuité, faible implication et sensibilisation des habitants.
La Zone à Faibles Émissions (ZFE) suscite un écho similaire : l’idée est comprise, parfois même approuvée, mais jugée mal expliquée et mal accompagnée, avec un risque d’exclusion pour certains habitants.
Enfin, la progression des pistes cyclables et des zones piétonnes est perçue comme une avancée positive. Mais elle souffre d’un défaut majeur : l’absence de concertation. Plusieurs aménagements sont jugés dangereux ou mal conçus, nourrissant un sentiment d’écologie imposée.
En filigrane, une attente forte se dessine : une écologie de terrain, pragmatique et partagée, loin des postures idéologiques. Une écologie inclusive, qui ne pénalise pas les plus fragiles.
# 2 Le logement : l’urgence de redonner de l’air et du pouvoir d’habiter
- « Certains projets changent vraiment le visage des quartiers. »
- « Il y a une vraie réflexion sur la ville apaisée dans certains endroits. »
- « Il faut cesser d’opposer logement et cadre de vie. On peut bâtir mieux, pas seulement plus. »
- « Il faut choisir entre touristes et actifs. »
- « Offrir des logements pour tous les profils, y compris les jeunes couples et les mères isolées. »
- « Les loyers deviennent inaccessibles, même pour des classes moyennes. »
- « Je suis étudiant, je galère depuis 3 mois à trouver un logement, même en colocation. »
- « L’Airbnbisation tue nos quartiers. On veut pouvoir rester dans notre ville. »
- « On veut des logements partagés, intergénérationnels, pas que des tours. »
- « Les prix explosent. On ne peut plus habiter Lyon. »
- « On chasse les classes moyennes. La ville devient un décor. »
- « Des projets mal concertés, mal pensés, mal vécus. »
- « Les commerces ferment. Il ne reste que des snacks et des Airbnb.»
L’enquête révèle une inquiétude massive autour du logement. La flambée des loyers est vécue comme un étranglement, et si l’encadrement mis en place est parfois cité positivement, beaucoup estiment que l’inflation des loyers est de plus en plus forte. Les difficultés touchent désormais tous les profils : étudiants, seniors, familles, ménages modestes et classes moyennes.
À cela s’ajoute une cri de quartiers comme la Croix-Rousse, le Vieux Lyon ou la Presqu’île. Derrière ce terme, une réalité : la perte d’habitants permanents au profit de logements touristiques, la hausse des loyers, et le sentiment de « Disneylandisation » d’espaces autrefois vivants. Une conséquence significative a également été évoquée : l’impact sur les commerces de proximité qui se retrouvent en difficulté et ferment les uns après les autres.
Enfin, beaucoup soulignent le lien entre logement et mobilité : se loger loin, c’est aussi subir des déplacements longs et coûteux, faute d’une offre de transport adaptée.
En résumé, les réponses citoyennes pointent une même direction : il faut construire plus, réguler mieux et penser un urbanisme plus inclusif et équilibré.
# 3 Les mobilités : besoin d’un choc de cohérence
- « Il y a plus de vélos, plus de voies cyclables, c’est bien. »
- « On commence à penser à l’Ouest lyonnais, enfin. »
- « On ne peut pas faire reposer toute la transition sur les cyclistes en bonne santé habitant le centre. »
- « En 2025, il est absurde de devoir avoir deux abonnements pour traverser la Métropole. »
- « Un vrai RER métropolitain avec un abonnement unique, c’est la base. »
- « Il faut des parkings relais bien faits, plus nombreux. Sinon, on ne lâchera pas la voiture. »
- « Tous les déplacements ne peuvent pas se faire en vélo. Il faut penser à tout le monde. »
- « Plus de bus la nuit, des transports qui vont dans toutes les directions. »
- « On a supprimé des voies pour les voitures, mais on n’a rien mis à la place. »
- « Les transports sont trop chers et mal adaptés en dehors de Lyon. »
- « Trop de bouchons, trop peu de solutions. »
- « Le vélo ne doit pas être une religion. »
Les réponses soulignent une évolution positive des mobilités : développement des pistes cyclables, progrès du réseau TCL, ou encore l’ambition d’un RER métropolitain. Mais une attente forte se dégage : moins de dogmatisme et plus de pragmatisme.
Le réseau TCL/Sytral est décrit comme saturé et incomplet, notamment en périphérie, où de nombreux habitants se sentent mal desservis. Le projet de RER métropolitain apparaît alors comme un horizon incontournable, capable de relier efficacement les bassins de vie à la ville-centre.
Les manques concrets sont nombreux : absence de transports de nuit, mauvaise articulation entre voiture, modes doux et transports en commun, tarifs complexes. Une demande récurrente : la mise en place d’une tarification simplifiée et intégrée pour faciliter les déplacements.
Beaucoup aimeraient « laisser leur voiture à la porte de Lyon »… mais ne trouvent ni parking relais, ni place de stationnement sécurisée, ni fréquence de transport satisfaisante. Les infrastructuresexistantes (Gorge de Loup, Mermoz, Laurent Bonnevay) sont souvent saturées ou mal connectées aux lignes fortes.
Enfin, si le vélo est reconnu comme un mode de déplacement efficace, il ne peut pas être la réponse universelle. Le développement du réseau cyclable est salué, mais sa mise en œuvre trop unilatérale nourrit des tensions. Des aménagements mal conçus, jugés dangereux ou pénalisants pour la circulation, alimentent des tensions (Rockefeller ou Charpennes par exemple).
Le vélo doit s’inscrire dans une vision globale et inclusive des mobilités.
#4 Le cadre de vie et la sécurité : la qualité de vie en question
- « Il y a des efforts sur la médiation, on le voit dans certains quartiers. »
- « Une ville agréable, c’est d’abord une ville respectée. »
- « Des espaces publics propres et respectés, c’est le minimum. »
- « Plus de présence humaine : police, agents, médiateurs. »
- « Qu’on sanctionne les incivilités. Qu’on fasse respecter les règles. »
- « On veut se sentir en sécurité dans les bus, sur les trottoirs, partout. »
- « On ne se sent plus à l’aise dans nos quartiers. »
- « Laisser-aller total sur la propreté. »
- « L’espace public est devenu un lieu de tension. »
Le cadre de vie quotidien revient avec insistance dans l’enquête. Beaucoup estiment que la Métropole a perdu en qualité d’entretien : manque de propreté dans les centres urbains, déchets mal collectés, incivilités non sanctionnées. Ce n’est pas seulement une question technique : c’est une question de respect mutuel et de dignité des lieux. C’est une demande d’un vrai service de proximité visible et efficace.
La sécurité est une préoccupation partagée. Elle est exprimée sans agressivité, mais avec une inquiétude croissante. Ce que demandent les habitants, c’est une présence humaine visible et rassurante, notamment dans les transports, les espaces publics et aux abords des établissements scolaires.
Les réponses montrent que la demande n’est pas celle d’une surenchère répressive, mais bien d’un équilibre entre prévention, médiation et sanctions. En résumé : faire respecter les règles pour que l’espace public redevienne un lieu de partage et de sérénité. Un habitant résume bien cette attente : « L’espace public doit redevenir un bien commun, pas un no man’s land. »
Enfin, beaucoup regrettent que les grands discours sur l’aménagement durable se traduisent trop peu dans leur quotidien : des bancs publics qui disparaissent, des espaces communs mal entretenus, des lieux de convivialité qui se raréfient, des espaces sportifs librement accessibles qui sont fermés tour à tour. Derrière ces remarques se dessine une attente : une ville à taille humaine, où l’on se sent reconnu et respecté.
🌍 S’inspirer d’ailleurs, tout en gardant notre identité
De nombreuses réponses évoquent aussi des modèles inspirants. Barcelone, Strasbourg, Amsterdam, Berlin, Tokyo… De nombreuses villes ont trouvé des équilibres innovants : végétalisation intelligente, superblocks, conseils citoyens jeunes, navettes fluviales, tramways cargo, gratuité des transports en cas de pic de pollution, limitation d’Airbnb, urbanisme participatif…
Mais une conviction revient : il ne suffit pas de copier ! Ces exemples montrent qu’un autre modèle est possible, à condition d’agir avec méthode, écoute et en impliquant les toutes communes.
Ces idées, il faut s’en inspirer et les adapter pour inventer un modèle lyonnais à la hauteur de nos ambitions : durable, cohérent, partagé. Pour construire une Métropole de demain en cohérence avec notre territoire, notre histoire et notre population. Et surtout faire avec les citoyens et les élus locaux.
Mobilités : penser des systèmes vraiment intégrés
- Barcelone a été citée à de nombreuses reprises dans l’enquête, notamment pour ses superblocks : des quartiers apaisés, où l’espace public est redistribué au profit des habitants, avec plus de verdure, moins de voiture, plus de vie. Ces aménagements ont aussi redonné de la valeur aux commerces de proximité et permis de baisser la pollution.
- Strasbourg et Copenhague sont les références souvent évoquées en matière de mobilités douces. Mais ces villes n’ont pas seulement investi dans le vélo : elles ont pensé la cohabitation entre tous les modes, avec des parcs relais bien situés, des transports publics fréquents et une signalétique claire pour tous.
- Bordeaux, Toulouse, ou encore le Grand Reims testent des formes innovantes de transport à la demande, notamment la nuit, pour éviter le sentiment d’abandon dans les quartiers périphériques ou ruraux et renforcer la sécurité.
Ce que nous pouvons retenir : La mobilité n’est pas un enjeu technique, c’est un enjeu d’égalité. Il faut penser réseau, continuité, accessibilité, et simplicité tarifaire. Nous avons besoin d’une mobilité sans couture !
Urbanisme et logement : inventer la densité désirable
- Berlin a lancé depuis plusieurs années des programmes de reconversion de friches urbaines confiées à des collectifs d’habitants ou à des coopératives. Cela a permis de créer des logements abordables, des tiers-lieux, des jardins partagés et d’éviter la spéculation.
- Amsterdam a levé les plafonds de hauteur des immeubles tout en imposant des normes architecturales exigeantes, permettant plus de logements, moins d’étalement urbain et donc moins de pression sur les mobilités et les sols naturels.
- Saint-Malo ou Vienne ont mis en place des quotas de résidences principales ou des encadrements très stricts d’Airbnb, pour éviter la « muséification » des centres-villes.
Ce que nous pourrions retenir : Il ne s’agit pas de choisir entre densité ou qualité de vie, mais de les réconcilier. Cela passe par des règles intelligentes, des concertations honnêtes et une vraie vision du long terme.
Végétalisation et résilience : des villes qui respirent
- À Leicester (Royaume-Uni), la ville a installé des abribus végétalisés dans tous les quartiers pour favoriser la biodiversité urbaine et baisser la température.
- À Paris, le programme « Rues aux écoles » a permis d’aménager des dizaines de cours d’école en îlots de fraîcheur ouverts aux riverains en été.
- Tokyo, a lancé un programme massif de récupération des eaux de pluie pour alimenter la ville en période de sécheresse.
- Barcelone expérimente des forêts urbaines pénétrantes, sortes de coulées vertes traversant la ville et reliant les parcs entre eux, avec un effet « climatisation naturelle ».
Ce que nous pourrions retenir : La végétalisation n’est pas décorative. Elle est sanitaire, sociale, et stratégique. Elle doit devenir une infrastructure de santé publique, pensée dans tous les quartiers, y compris les plus minéraux.
Démocratie urbaine : faire avec les habitants, vraiment
- À Bergen (Norvège), un « shadow conseil municipal » de jeunes peut émettre des avis, des amendements ou des veto symboliques aux décisions du conseil municipal adulte. Une manière de faire entrer la voix de la jeunesse dans la fabrique urbaine.
- À Porto Alegre (Brésil), le budget participatif citoyen a été utilisé pendant des années pour affecter une part réelle des investissements à des projets votés localement.
- À Berlin et Barcelone, la concertation citoyenne est encadrée juridiquement, et les habitants peuvent déclencher des référendums locaux sur les grands projets urbains.
Ce que nous pourrions retenir : Il ne suffit pas de consulter, il faut impliquer, valoriser, responsabiliser. C’est par la démocratie locale que se regagne la confiance.
Et nous, que voulons-nous pour Lyon ?
Nous ne croyons pas aux recettes magiques, mais nous sommes convaincus que la Métropole de Lyon peut devenir un territoire exemplaire, si elle sait s’inspirer du meilleur d’ailleurs… tout en restant fidèle à son histoire, à ses quartiers et à ses habitants.
Cela suppose :
- De voir loin : climat, logement, mobilités, alimentation…,
- D’agir localement avec les maires, les citoyens, les associations…,
- De penser ensemble, pas contre, pas au-dessus.
La Métropole de demain sera celle qui saura conjuguer le souffle d’une ambition européenne avec l’ancrage d’une proximité retrouvée.
Ce que l’enquête révèle aussi : d’autres angles à ne pas oublier
En plus des grands défis liés à l’environnement, aux mobilités, au logement et au cadre de vie, l’enquête a mis en lumière des sujets transversaux, trop souvent négligés, mais essentiels pour comprendre l’avenir de la Métropole.
Territoires oubliés, Métropole fragmentée
👉 « Dès qu’on sort de Lyon, on a l’impression d’être dans une autre métropole. »
Derrière ce constat, c’est une véritable aspiration à l’équité territoriale qui s’exprime. Beaucoup dénoncent une Métropole à deux vitesses : d’un côté, Lyon et quelques quartiers « vitrine » où se concentrent les investissements, et de l’autre, la première et la deuxième couronne, voire les zones rurales comme le plateau nord, qui se sentent délaissés. Cette fracture nourrit un sentiment d’injustice et d’abandon, avec des habitants qui peinent à accéder aux mêmes services publics ou aux mêmes opportunités de mobilité et d’emploi.
La réponse doit être claire : il faut réparer les fractures territoriales. Cela passe par le développement d’une Métropole multipolaire, où plusieurs centralités fortes émergent (Vaulx-en-Velin, Givors, Meyzieu, Ouest lyonnais…), où les services publics sont mieux répartis et où les investissements ne se concentrent pas uniquement sur le centre. Une Métropole harmonieuse ne peut pas être recentrée sur Lyon seule : elle doit irriguer l’ensemble du territoire.
Les jeunes, grands absents du débat public local
👉 « Je suis étudiant, je vis à Lyon depuis 4 ans, mais je n’ai jamais été consulté sur rien. »
Ce témoignage résume bien le sentiment d’exclusion politique de toute une génération. Les jeunes apparaissent comme les grands oubliés du débat métropolitain, alors même qu’ils sont en première ligne sur les défis du logement, de la mobilité, de l’emploi et du climat. Et pourtant, l’enquête révèle qu’ils ont des idées très concrètes : conseils citoyens de jeunes, budgets participatifs étudiants, démocratie numérique, orientation post-bac…
Si nous voulons penser l’avenir, il faut écouter la jeunesse. Cela signifie créer un Conseil métropolitain des jeunes, organiser des consultations citoyennes régulières sur les grands sujets (logement, environnement, mobilité) et mettre en place des budgets participatifs étudiants. La jeunesse n’est pas un public secondaire : c’est une ressource d’innovation démocratique et sociale.
Souveraineté alimentaire et circuits courts
👉 « Pourquoi mange-t-on des tomates espagnoles alors qu’il y a des maraîchers à 15 km ? »
La question de l’alimentation a émergé avec force. Au-delà de l’écologie, c’est un sujet de justice sociale, de santé et de culture. Bien manger à prix abordable, soutenir les producteurs locaux, réduire la dépendance aux importations : autant de préoccupations partagées par tous les profils intérrogés. Parmi les propositions souvent évoquées : la création d’une sécurité sociale de l’alimentation, le développement de régies agricoles publiques ou les marchés de producteurs de proximité.
Faire de la Métropole de Lyon un territoire nourricier doit devenir une ambition politique. Cela pourrait passer par la mise en place de régies agricoles locales pour approvisionner les cantines, la création de zones de résilience alimentaire (à l’image de Grenoble) et le développement de marchés de producteurs dans les quartiers populaires.
En liant écologie, pouvoir d’achat et santé publique, la souveraineté alimentaire devient un axe stratégique pour l’avenir.
Une métropole à taille humaine : réconcilier la ville et ses habitants
👉 « On nous parle d’aménagement durable, mais moi je veux juste retrouver un banc devant mon immeuble. »
« Je n’ai jamais su à quoi sert la Métropole. »
Ces phrases disent beaucoup. Au-delà des grands projets, ce que demandent les habitants, c’est de retrouver de la proximité et de la lisibilité. Une métropole qui ne soit pas une institution technocratique déconnectée de ses habitants, mais une collectivité qui construit le cadre de vie selon les besoins réels du territoire. Ce qui compte, ce sont les petits gestes du quotidien : des bancs, des espaces de rencontre, une institution qui parle clair et qui écoute.
Cela suppose de réconcilier la ville et ses habitants. Une gouvernance plus incarnée, plus lisible, mais aussi un urbanisme du quotidien : créer des espaces conviviaux, renforcer la présence de services publics accessibles, rendre la Métropole compréhensible pour ses habitants. En somme, il faut retisser le lien de confiance entre l’institution et ceux qui y vivent.
Pour nous il est également important de créer un véritable sentiment d’appartenance à la Métropole de Lyon. Inculquer la fierté de vivre dans une métropole qui se positionne à la hauteur des grandes métropoles européenne tout en restant à taille humaine.
Redonner du pouvoir local : pour une démocratie coopérative
👉 « Les maires connaissent leur territoire, pourquoi ne pas leur donner les moyens d’agir ? »
« La Métropole devrait faire avec les gens, pas au-dessus d’eux. »
Beaucoup de participants expriment une lassitude face à une gouvernance perçue comme trop verticale. Ils souhaitent que la Métropole coopère mieux avec les communes, qu’elle donne plus de moyens aux maires, et qu’elle associe réellement les citoyens. Certains vont jusqu’à demander des référendums locaux ou un véritable statut pour les mairies d’arrondissement.
Nous plaidons pour une démocratie coopérative. Cela ne veut pas dire recentraliser autoritairement ni sombrer dans un chaos participatif. C’est une voie centriste : faire confiance aux maires et aux citoyens, leur donner de vrais outils de dialogue, renforcer les coopérations entre niveaux de décision. La Métropole doit être un espace de coordination et de solidarité, pas de domination.
Ensemble, ces cinq angles complémentaires rappellent une évidence : la Métropole de demain ne se construira pas seulement sur des infrastructures ou des plans techniques. Elle doit être plus équitable, plus participative, plus attractive, plus lisible et plus proche de ses habitants.